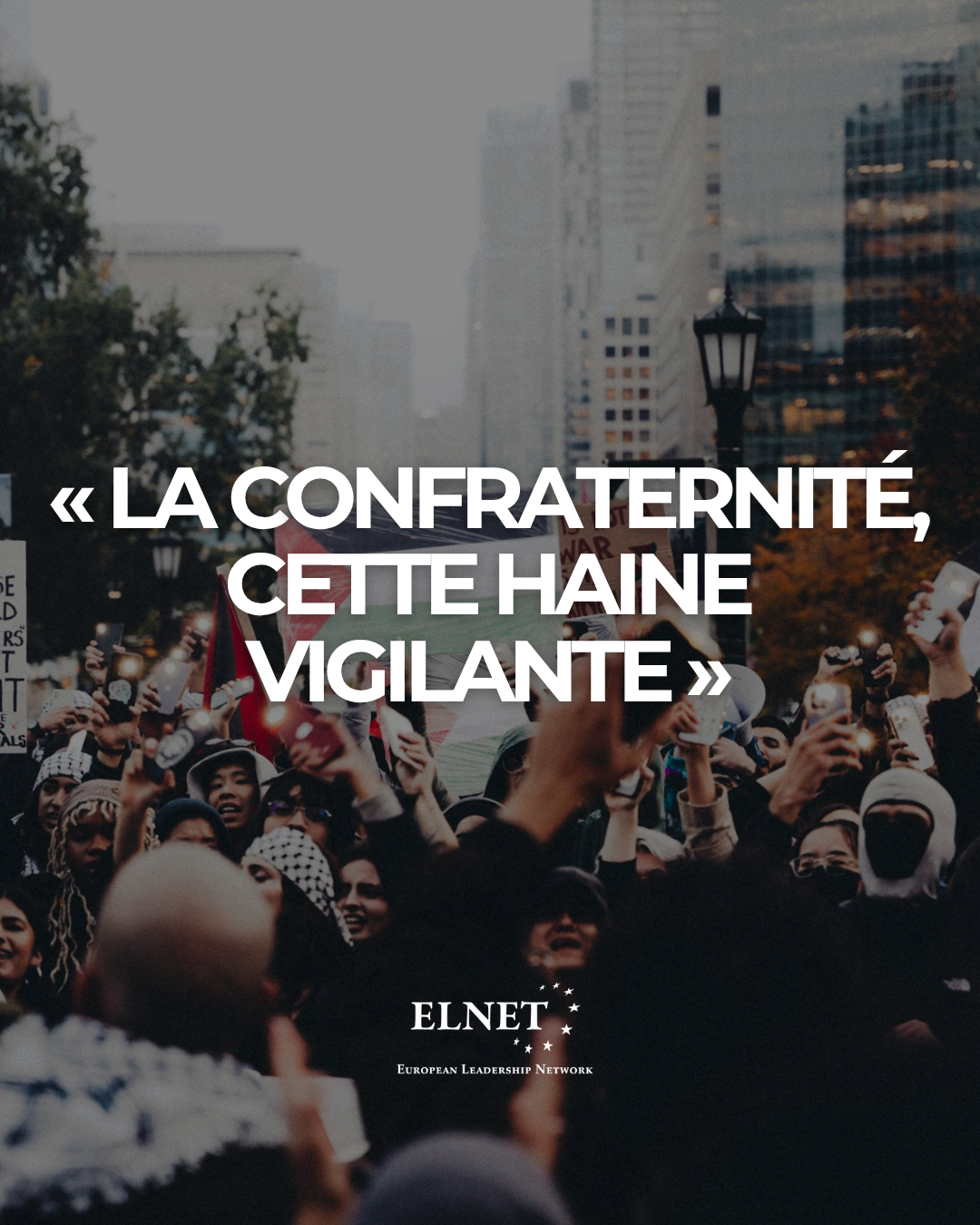Titre emprunté à la citation de la journaliste Carmen Tessier (1911-1980).
[Tribune – Stéphane Charbit. Entrepreneur et Communicant. Militant de #agirensemble]
On a cru, un instant, un très court instant, que le fracas des armes resterait loin de nous. Depuis les massacres du 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza, c’est pourtant en France et dans d’autres démocraties européennes, que se rejouent des lignes de front symboliques : rues, amphithéâtres, réseaux sociaux. La haine des juifs y a trouvé des parades nouvelles, parfois travesti sous le mot d’ordre, haine d’Israël, pendant que s’esquissaient des convergences entre extrême gauche et acteurs islamistes. Le tout sous le signe d’une fraternité paradoxale, que l’on pourrait nommer « Confraternité », non pas le soin porté à autrui, mais la solidarité serrée des mêmes contre les autres, une haine vigilante chargée de veiller ou d’entretenir la flamme, celle des crématoires d’Auschwitz ou de Dachau.
La solidarité contre
La mécanique est connue : les groupes se soudent plus facilement par l’ennemi partagé que par le projet commun. Dans de nombreuses mobilisations, l’orthodoxie s’énonce en mots d’ordre simples, indiscutables, et s’érige en police des frontières : qui hésite est « tiède », qui nuance « complice », qui s’inquiète de la montée de la haine des juifs « dévie le sujet ». Cette vigilance n’est pas la prudence des consciences ; c’est la garde prétorienne de la pureté. Elle crée une communauté de ressentiment où l’appartenance se prouve par l’intensité de l’hostilité. Le phénomène se voit dans les cortèges autant que dans les « ratios » en ligne : sommations de choisir son camp, listes d’indésirables, bannissements symboliques, procès d’intention. Cette confraternité négative promet la chaleur d’un collectif, mais ne tient que par le froid d’une mise à l’écart. Elle transforme un conflit tragique et complexe en théâtre moral binaire, où l’on se sauve en condamnant plus fort que le voisin.
Haine d’Israël, haine des juifs : la pente glissante
Critiquer un gouvernement, une armée, une stratégie, est légitime et nécessaire. Mais l’on glisse lorsque « Israël » n’est plus un État à juger, mais une essence à haïr ; lorsque « sioniste » devient une invective universelle ; lorsque la colère, au lieu de viser des choix politiques, s’abat sur des citoyens juifs en France. Là, la haine d’Israël cesse d’être une position et devient un vecteur : il accueille, maquille, ou délie une vieille passion triste qui n’avait pas besoin d’alibi pour renaître. La Confraternité joue précisément ce rôle : elle veille. Elle surveille que la haine ne s’assoupisse pas, la nourrit d’images, de chiffres brandis sans prudence, d’analogies absolues (« apartheid », « génocide ») qui, parfois, ne disent plus la réalité mais un désir de totalisation. Nommer ce glissement, ce n’est pas bâillonner la critique d’Israël ; c’est protéger la possibilité même d’une critique juste, qui ne déshumanise personne.
La convergence des colères
On a vu, ces derniers mois, se dessiner des proximités entre l’extrême gauche et mouvances islamistes : slogans partagés, iconographie commune, récits jumeaux de l’opprimé absolu et de l’oppresseur absolu. Ce n’est pas une alliance solide ; c’est une coalition d’hostilité. Elle se fonde moins sur un horizon politique commun que sur une grammaire affective identique : la dénonciation, la radicalité performative, l’excommunication des nuances. Cette convergence a un prix : elle fragilise la France républicaine qui tente de tenir ensemble la solidarité avec les civils palestiniens, victimes d’une guerre déclenchée et entretenue par le Hamas et le refus de la haine des juifs, le soutien au droit international et la condamnation explicite du terrorisme. Elle brouille les repères des jeunesses militantes, auxquelles on propose une éthique instantanée, « indigne qui n’indigne pas assez », à la place d’un engagement patient, informé, universaliste.
L’entrisme « frériste » : l’art de durer
Dans ce paysage, la stratégie des Frères musulmans agit comme un accélérateur discret. Elle n’a pas besoin de bruit ; elle préfère les infrastructures. On la connaît : la prédication qui s’habille d’éducation populaire, maillage associatif et caritatif, implantation municipale, formation de cadres, production de normes quotidiennes (vêtements, sociabilités, séparations), mise en récit de la minorité comme corps distinct à protéger des « corruptions » extérieures. À l’ère numérique, s’y ajoutent des prédicateurs connectés, des relais médiatiques, des écosystèmes d’influence. La cause palestinienne, fonctionne ici comme cause-passerelle. Elle permet d’élargir les cercles, de légitimer des porte-parole, de pousser des mots d’ordre qui esquissent une société parallèle. Ce n’est pas la violence directe ; c’est la préparation des mentalités : l’horizon d’une communauté « plus pure » que la République, plus fidèle que la Nation, plus sûre que le pluralisme. L’entrisme ne capture pas seulement des institutions ; il fabrique des évidences, il naturalise des séparations.
Pourquoi ai-je emprunté cette formule à Carmen Tessier
« La Confraternité, cette haine vigilante » : la formule n’accuse pas les solidarités, elle les discrimine. Elle distingue la fraternité authentique, celle qui veille sur, qui protège, qui soigne, de la confraternité de façade, qui veille contre, qui s’entretient du feu qu’elle prétend combattre. Elle est un test : si ma communauté exige que je haïsse pour appartenir, elle ne me propose pas la justice ; elle m’invite à l’ivresse de l’unanimité. Appliquée à la séquence actuelle, cette grille éclaire la façon dont convergent campisme, ressentiment et opportunisme politique. Elle explique pourquoi les remises en cause les plus élémentaires (condamner le terrorisme du Hamas, refuser l’essentialisation des Juifs, défendre les libertés académiques) deviennent, dans certains cercles, des actes de dissidence. Elle dit, aussi, que la majorité silencieuse, juive, chrétienne, musulmane, athée, croyante, de gauche, de droite, est sommée d’entrer dans une dramaturgie qui n’est pas la sienne.
Pour une vigilance qui protège, pas qui traque. Que faire ?
Trois lignes, simples et fermes, peuvent guider une réponse démocratique, car il n’est pas trop tard !
Tenir la frontière pénale sans confondre : protéger la liberté de manifester et de critiquer, mais sanctionner sans trembler l’appel à la haine, l’apologie du terrorisme, l’intimidation des personnes et des institutions. La République n’a pas à tolérer ce qui nie ses principes.
Exiger la transparence : financements, affiliations, porte-parole des associations ; pluralisme des interlocuteurs ; vigilance sur les influences étrangères. L’opacité nourrit la suspicion et offre un terrain fertile aux entreprises d’entrisme. La lumière n’est pas une stigmatisation ; c’est une condition de la confiance.
Refaire des alliances positives : soutenir les acteurs de tous bords, y compris musulmans, qui défendent le cadre républicain, les libertés, l’égalité femmes-hommes, et qui refusent les assignations identitaires. À l’école et à l’université, protéger les étudiants et enseignants ciblés, garantir la contradiction informée, et refuser les tribunaux de la pureté.
Il y a, au fond, deux types de vigilance. La première, civique, veille sur la dignité de tous, refuse les essentialisations, tient le droit et les faits contre la tentation de l’absolu moral. La seconde, confraternelle, veille la haine comme on veille un brasier : elle s’assure qu’il ne faiblisse pas, quitte à l’alimenter de bois humide que sont les approximations, amalgames, figures de styles mortifères et mensonges grossiers.
Nous n’avons pas besoin d’une vigilance qui traque. Nous avons besoin d’une vigilance qui protège. Le conflit israélo-palestinien mérite mieux que nos binarités confortables ; les juifs de France méritent mieux que l’hostilité travestie ; nos concitoyens musulmans méritent mieux qu’une assignation à l’islamisme. La fraternité républicaine n’est pas une chaleur de meute. C’est une promesse de décence commune. Elle ne demande pas des voix qui crient plus fort ; elle demande des consciences qui tiennent plus juste. C’est à cette condition que cette citation cesse d’être un diagnostic et redevient un avertissement, pour que, demain, la vigilance ne soit plus celle de la haine, mais celle du soin.