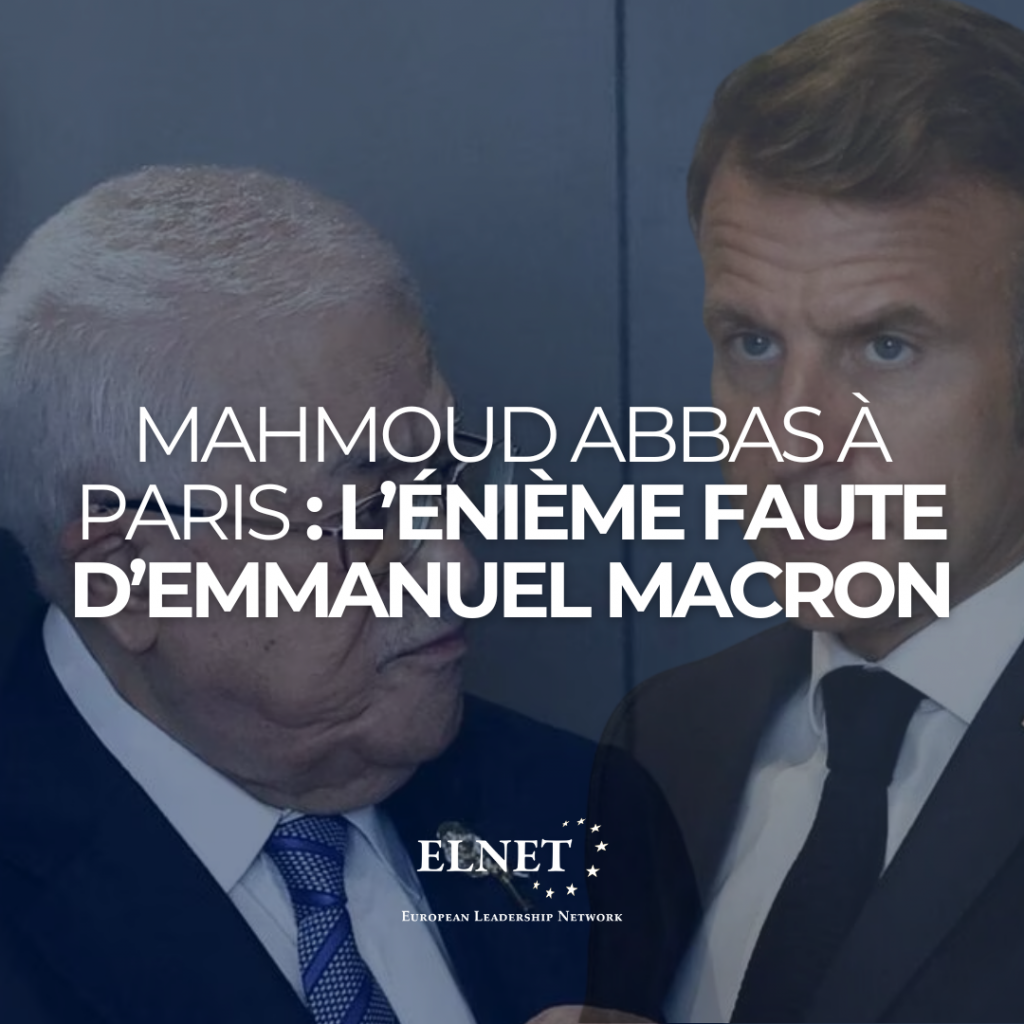La visite officielle de Mahmoud Abbas en France, à l’invitation d’Emmanuel Macron – un 11 novembre, de surcroît –, constitue une énième faute diplomatique du Président de la République. Elle s’inscrit dans la continuité de sa reconnaissance unilatérale et sans condition d’un État palestinien en septembre dernier, expression d’une volonté obstinée de ressusciter de force une « solution à deux États » que les Palestiniens n’ont jamais voulue, que les États arabes n’ont jamais considérée et que les Israéliens ne veulent plus.
En offrant un accueil présidentiel hautement symbolique, Emmanuel Macron commet une double faute : il renforce un dirigeant totalement dépourvu de légitimité, et s’enferme dans une lecture biaisée et anachronique du Proche-Orient – au détriment d’Israël, de la vérité, de la cohérence diplomatique française, et surtout de la paix.
Car Mahmoud Abbas est tout sauf un « partenaire de la paix ». Il n’est ni un dirigeant légitime, ni réformateur, ni unificateur, ni crédible sur la scène internationale. Il incarne un système bloqué, autoritaire, corrompu, ambigu face à la violence, complaisant envers la haine, et incapable de proposer une voie pacifique à son peuple tout en alimentant la confrontation permanente avec Israël. Cette qualification relève davantage du besoin occidental de maintenir un interlocuteur palestinien identifiable que de la réalité.
D’abord, Mahmoud Abbas ne possède aucune crédibilité démocratique pouvant justifier de le recevoir en grande pompe sous le titre de « Président de la Palestine ». Son mandat a expiré en 2009, et il a depuis systématiquement refusé d’organiser de nouvelles élections en sachant que le Hamas les remporterait. Il gouverne par décrets, sans parlement fonctionnel et sans véritable mandat populaire. Un tel déficit démocratique n’est pas un simple problème institutionnel : il rend impossible toute concession historique. Un dirigeant illégitime ne peut ni engager son peuple dans un compromis, ni le préparer psychologiquement aux sacrifices qu’exigerait une paix durable. Son pouvoir repose sur l’immobilisme, non sur la résolution du conflit.
À cela s’ajoute son incapacité structurelle à imposer l’ordre dans les territoires palestiniens. Abbas ne contrôle pas Gaza, tombée aux mains du Hamas depuis 2007, et peine à affirmer son autorité dans les zones de Judée-Samarie/Cisjordanie dont il est supposément responsable, où des groupes armés – parfois issus du Fatah – agissent de manière autonome. Cette fragmentation du pouvoir vide toute négociation de son sens. Même si Abbas signait un accord avec Israël, il n’aurait ni l’autorité ni les capacités sécuritaires pour l’appliquer au regard d’une population palestinienne qui continue de soutenir majoritairement le Hamas, son idéologie, sa guerre sainte. La paix nécessite un acteur capable d’exercer le monopole légitime de la force, condition qu’Abbas est incapable de remplir.
Mais au-delà de ces faiblesses internes, c’est la nature même de sa stratégie politique qui fait de lui un obstacle majeur à la résolution du conflit. Depuis des années, Abbas entretient une double rhétorique : un discours modéré pour les chancelleries occidentales, et un discours radical interne où il glorifie les « martyrs », accuse les Israéliens de « génocide », et refuse toute reconnaissance réelle d’Israël comme État-Nation du peuple Juif. Cette duplicité est au cœur de son système de pouvoir qui consiste à afficher la modération pour préserver le soutien international, tout en consolidant une mobilisation intérieure fondée sur un récit maximaliste et conflictuel. Il aura ainsi fallu des mois de pressions – notamment de la France – pour qu’il consente à une condamnation, vague et tardive, des massacres du 7 octobre 2023, auxquels des membres du Fatah ont pourtant participé.
Cette ambivalence s’exprime aussi dans la politique de rémunération des terroristes et de leurs familles avec le système dit de « pay for slay », qu’Abbas défend vigoureusement en le qualifiant de « devoir national ». Ce mécanisme est l’un des obstacles les plus directs à la paix, car il crée un incitatif financier à la violence, institutionnalise l’héroïsation des assassins et envoie le message que le meurtre de civils israéliens est valorisé par l’Autorité palestinienne. Et même s’il en a officiellement annoncé la fin en février 2025 sous pression occidentale, le dispositif subsiste sous une forme plus opaque (le PNEEI – Palestinian National Economic Empowerment Institution) et via des canaux de contournement.
Aucun dirigeant qui maintient et justifie une telle politique ne peut être considéré comme un partenaire sincère, d’autant que l’éducation et les médias officiels perpétuent ce système. Les manuels scolaires palestiniens continuent d’effacer Israël des cartes, de glorifier la lutte armée et de déshumaniser « l’ennemi », malgré des condamnations internationales répétées. Les médias, contrôlés ou influencés par l’Autorité palestinienne, diffusent régulièrement des messages d’incitation ou de délégitimation, consolidant un imaginaire collectif incompatible avec la coexistence. Abbas aurait pu utiliser ces outils pour préparer sa société à la paix, mais il en a fait des instruments d’une rhétorique génocidaire qui se transmet de génération en génération.
Enfin, Mahmoud Abbas a depuis longtemps renoncé à toute démarche diplomatique constructive avec Israël en violation systématique des Accords d’Oslo. Il s’est engagé dans une stratégie d’internationalisation du conflit : recours systématique à l’ONU, plaintes devant la CPI, campagnes de délégitimation dans les forums internationaux. L’objectif n’est pas de négocier un compromis, mais d’isoler Israël et de contourner le dialogue bilatéral.
Sa venue à Paris en arborant sur sa veste une clé censée symboliser les « maisons palestiniennes perdues » après la défaite des armées arabes coalisées contre Israël en 1948 en est un énième exemple. Ce symbole est un rappel constant de la question des « réfugiés » palestiniens et du prétendu « droit au retour ». Ce droit n’a aucune légitimité juridique pour des individus n’ayant jamais habité les territoires israéliens qu’ils revendiquent, et il constitue une menace existentielle pour l’État juif – en plus d’être contraire à l’idée de la solution à deux États qu’il prétend soutenir, ainsi qu’à l’image d’homme de paix qu’il cherche à incarner. Il ne s’agit que d’une provocation politique, un rappel permanent adressé à Israël que la revendication demeure non négociable, et une manière de présenter symboliquement la destruction de l’État juif comme un objectif légitime. Derrière ce geste ne se cache rien d’autre que la négation implicite de l’existence d’Israël et la valorisation d’un maximalisme irréalisable, qui rend tout compromis impossible.
Ainsi, présenter Mahmoud Abbas comme un « partenaire pour la paix » ne correspond pas à ce qu’il est, mais à ce que certains voudraient qu’il soit. Cette illusion diplomatique remplace l’analyse par le souhait et substitue un acteur fictif à la réalité d’un dirigeant à l’opposé du rôle qu’on lui prête.